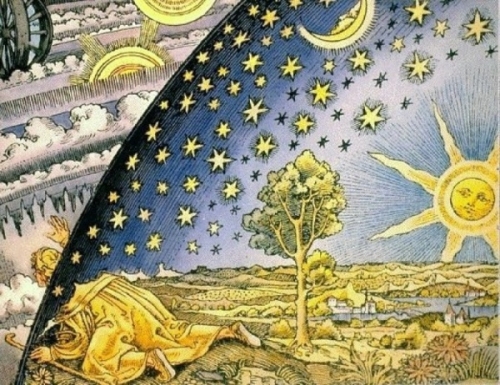La fin de la préhistoire
On estime à environ 10K ans BC (ou BCE) l'invention de l'agriculture, au levant, pendant la période du néolithique dite du "Khiamien". Les pointes du type d'El Khiam se trouvent (on en trouve) en palestine, en gros.
On note la différence entre sédentarité et agriculture, les débuts de la seconde consistant à moissonner des céréales sauvages.
On rappelle que Avant JC, Before Christ, Before Common Era, Avant Ere Commune, AEC, sont synonymes.
Le Mésolithique entre paleo et néo lithique est la période intermédiaire, disons après 10K BC.
Göbekli Tepe
Le site de Göbekli Tepe est particulièrement intéressant: situé en 11K BC, en gros le plus ancien sanctuaire connu.
Des pierres étranges, sculptées avec des figures d'animaux sauvages.
On rappelle que la pyramide de Khéops est daté de 2,5K BC, 7000 ans après, c'est dire.
Le site serait une manifestation illustrant une théorie donnant aux cultes chamaniques des chasseurs cueilleurs une tendance à faire des sanctuaires, donc des lieux stables, ce qui induit une sédentarisation et donc l'agriculture, pratique qui serait donc issue d'une pratique religieuse en évolution.
On en sait bien sur absolument rien, mais l'idée est intéressante: le social "serait" issu du religieux: tu parles on est au coeur de la polémique, les conceptions du religieux comme issues du social étant bien sur majoritaires...
Durkheim
C'était d'ailleurs le point de vue de Durkheim, l'illustre sociologue français, partisan de l'éviction de la philosophie par la sociologie, et mort en 1917, inconnu de tous (je veux dire visuellement), sauf de son neveu Mauss et de tout ce qui suivit. Il est le théoricien des "faits moraux".
Il est l'auteur de “Je ne vois dans la divinité que la société transfigurée et pensée symboliquement”. Par ailleurs, il prophétisa un retour du religieux, et se trouve considéré comme continuateur des néo religieux du siècle précédent, une sorte de socialiste, donc, on en a parlé.
Il est traditionnellement opposé à Max (Weber) comme Holiste contre un individualiste méthodologique, mais il est comme le boche (mort en 1920) attaché à définir la sociologie comme une science. Weber est le théoricien du "désenchantement du monde" et de la "domination".
De plus, Boudon, pour des raisons à éclaircir, considérait les deux en fait, comme des individualistes. Ces raisons sont liées au relativisme, dont Boudon fait grâce à Durkheim de ne pas le soutenir complètement (2) en disant explicitement que l'individu n'est pas un produit de l'histoire.
Girard
On pense aux conférences que faisaient à la fin de sa vie le vieux Girard, sur Catal Höyük, site datant de 8K BC, et donc déjà agricole: la situation est déjà différente, et là il y avait le sacrifice. On y trouve même le plus vieux plan de ville connu.
Au fait, je ne résiste pas au plaisir de vous faire part de mes obsessions:

Au passage on peut noter au sujet de Catal Höyük plusieurs choses, liées aux théories de Descola: l'homme chasseur cueilleur animiste se transformerait en sédentaire puis agriculteur en changeant ses représentations, il deviendrait analogique, lors de l'"explosion symbolique" que constitue la mutation.
Un autre point est le léopard: l'identification animiste de l'homme au léopard fait de la chasse au léopard une sorte de lynchage, la chasse aux autres animaux introduisant le sacrifice par la la substitution. L'idée est particulièrement intéressante, la transition au sacrifice se faisant par une séparation entre humain et animal qui marque les civilisations agricoles: on y rejette la nature et le passage animiste vers analogisme (par introduction de la différence aussi entre les intériorités) illustrerait la chose.
Todd
Il faut noter cette théorie, à laquelle je rattache Girard, et qui est de considérer cette idée d'ailleurs catholique, de la notion de dégénérescence dans l'histoire: au départ, on avait des chasseurs cueilleurs animistes sympa et bonhommes, vivant libres et nus dans des familles nucléaires. Ce n'est qu'au passage à l'agriculture qu'on invente les maladies (il parait qu'à Göbekil Tepe régnaient d'horribles infections) et les sacrifices humains nécessités par les cohabitations. On invente les familles communautaires et autoritaires, les oppressions et les empires.
Dans un premier temps victorieux et innovateurs, ces systèmes chassèrent les systèmes primitifs aux frontières du monde connu (en Europe, par exemple, ou prévalent les systèmes nucléaires, inventeurs de la liberté politique), et le centre du monde devint le pire du monde (Daech au moyen orient)...
De la même manière, les systèmes primitifs totémiques et cannibales, étaient (parait-il) considérés par les théories des religions comparées (spécialité des cathos) d'avant Durkheim comme dégénérés: oubliés de Dieu et damnés, ils étaient le produit d'une décadence.
Il y a ainsi plusieurs manières de considérer notre monde comme déclinant, ce déclin ayant des origines et des formes multiples, mais l'âge d'or étant toujours derrière, comme dirait Henri Salvador, et d'autres.
La sociologie elle même, fondée par Durkheim et Weber, se définirait comme la science qui explique la validité effective des normes sociales, c'est à dire en gros, pourquoi on obéit(1). La question est bien sur de la relation entre la normativité et la religion.
Durkheim présente toute une série de concepts "différence sacré/profane", "conjonction obligation/désirabilité", et surtout similarité (le terme "structural" était il utilisé par Durkheim?) entre morale et sacré. Pour finir par définir le religieux comme issu du social...
On ne peut qu'être déçu (au vu des découvertes archéologiques mentionnées ci-dessus) de la conclusion. On remarquera, et on ne se lassera pas de le faire, car cela explique cela, la totale absence de mention du nerf de la guerre, pourtant témoigné partout: les gens sont pourtant bien persuadés de la présence d'un monde au delà du monde, d'une transcendance, d'un être caché, d'un objet G. Cette évidence, Durkheim et tous ses successeurs, en gros le reste de ce qui veut toujours succéder à la philosophie, ne conçoit même pas qu'elle puisse avoir un pouvoir de conviction, ni pour les fidèles, ni pour leur analystes... Girard lui même, le grand chrétien, et cela en fait un français comme un autre en est tout aussi éloigné, et c'est ce qui ruine ses prétentions, y compris aux yeux des archéologues et aussi, justement, des philosophes.
Car l'"autre monde" fait partie de l'ontologie humaine, et n'en considérer qu'une partie, c'est faire de la science dans un bac à sable. Vouloir simplement démasquer l'illusion que serait cette croyance c'est se fourvoyer et voilà ma théorie: Dieu existe, c'est les gens qui le disent. Ne pas les croire c'est les prendre pour des cons et cela n'est pas acceptable, c'est être con soi même, c'est à cela qu'on les reconnait. Respect pour les masques, please.
Revenons aux chasseurs cueilleurs, sans dieu ni maitres. Vraisemblablement animistes, ou au pire totemistes au sens de Descola, (Durkheim, parle bien de totem au sujet des religions australiennes), ils ne sont évidemment pas monothéistes, ni même théistes en fait: la notion de Dieu ne s'identifie pas au religieux, c'est l'évidence. Ils se voient pourtant en communication avec un autre monde, et cela est l'essentiel: et qu'on ne me dise pas qu'un athlète nu vivant dans un forêt avec sa famille dans un monde qui me tuerait en une demi heure n'a pas le sens des réalités. Il est tout sauf un ivrogne cannabisé qui compte les tâches des jaguars en pleurant: il sait parfaitement la différence entre les mondes, la preuve il est en fait ultra rationnel et vivant! Le religieux c'est autre chose, et c'est à définir.
Revenons à Durkheim: les faits moraux selon lui se doivent d'être partagés de manière inconsciente dans une collectivité, c'est là leur nature.
On a là tout ce qui fait la suite de cette absurdité métaphysique qu'est la sociologie: la porte ouverte à la réification de l'entité dominatrice non seulement invisible, mais inconsciente (elle n'est visible et consciente que pour les "scientifiques", seule la masturbation intellectuelle étant féconde et remède contre l'aveuglement, la surdité étant autre chose).
Weber
On passe à Weber. Tout comme Durkheim, il s'appuie sur la distinction kantienne entre règles techniques et morales, mais la distinction faite est entre les buts: pour les unes il s'agit de modifier le réel, pour les autres de satisfaire à un principe. C'est la différence entre téléologique et éthique. Admirable expression de la nature de la discipline allemande: obéit, c'est pour LE bien! Durkheim, en français qu'il est, faisait la différence avec la sanction, qui caractériserait l'obligation morale pure...
Weber explique l'obéissance par des critères variés, c'est la tétralogie croyance, droit, coutume, intérêt. A partir de là le religieux émerge du social d'abord magique, tout comme chez Durkheim. Le résultat est l'aspect sacré des normes, validées par la relation avec l'au delà enfin symbolisé.
Weber ajoute l'explication de l'immuable social, associé au sacré: l'obéissance est permanente, cela en fait la force.
Encore cette idée de la civilisation issue d'une dégénérescence et d'un aveuglement...
(1) http://journals.openedition.org/assr/1058
(2) https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-1-2006-4-page-877.htm