Les modes d'existence
J'avais commencé par faire mon Derrida et écrire "existance"...
Un magnifique écrit de Latour lui même (1), cet immortel génie qui arrive à s'approcher et à donner du corps à mon intuition de l'objet G, voire à parler d'ontologie comme il faut, enfin, on est tout de même en plein dans le délire constructiviste, une sorte de chewing gum à la fois addictif et repoussant, en tout cas qu'on se doit de cracher si on veut boire ensuite un verre de vin, un mode d'existence donc.

le vla, le génie.
C'est à propos d'un inconnu, Etienne Souriau, amateur de peinture et d'esthétique, en fait un métaphysicien de première bourre qui publia en 1943 un truc sur les modes d'existence, commenté par son disciple Latour. Il fut tout de même le directeur de thèse d'Eric Rohmer et classa 7 arts, dont le Cinéma (en dernier).
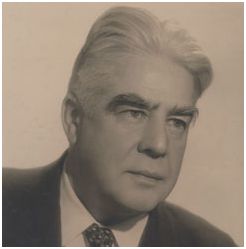
Le vla, le vieux philosophe.
Je maintiens par contre que Latour est un génie, sa définition du politique(2) étant très exactement ce qu'on peut en dire, et son ontologie si elle mène là, doit avoir des cotés positifs.
Le politique
On rappellera ici que le rond qui oppose (diamétralement) "un" et "multiple" reliés en montant par la représentation et en descendant par l'obéissance, toutes deux matérialisées conceptuellement par des arcs (de cercle).
Description géniale qui illustre un l'irréductibilité du politique, deux sa nécessaire absence de transparence.
L'irréductible est patent, et depuis Schmitt montre qu'il y a bien une ontologie à contempler, c'est à dire que les mots ont plus que des sens, ils sont des existences propres, en tant qu'exprimant du réel fictif, enfin bref, je suis constructiviste quelquepart...
D'autre part, au coeur de mes désespoirs sur la bêtise et la laideur du monde, il y a bien sur ce fantasme type walt dysney d'une raison qui s'exprimerait sans partage. Latour devrait donc soigner mes maux, mais j'ai bien l'intention de me défendre. Disons que, bien au contraire, je crois que c'est la perte du symbolique, c'est à dire précisément l'illusion de la transparence dont nous souffrons, nous dont moi. Car la raison, et c'est ce que je reconnais à Latour n'a pas de bornes: on peut dire et penser ce qu'on veut.
Les modes
Ces modes là constituent une ontologie, c'est à dire un classement des entités existantes. On y va tout de suite, il y a le phénomène, la chose, l'âme, l'être de fiction, dieu. A chaque fois, on a une sorte d'être et le grand nombre de ceux ci veut, c'est Latour qui le dit construire un monde dit "multi-réaliste" qui s'analyserait suivant ces modalités là.
Bien sur le poison constructif veut changer le rationnel et prendre pour argent comptant tout cela, le but étant le grand retour aux thérapies qui marchent (on s'agite en dansant autour d'un cochon mort). Une fois cela dit et maintenu en arrière plan, on ne peut que respecter cet élargissement de la représentation: plus qu'un régression de la civilisation, certes projetée, on veut surtout parler directement dans le langage qu'il faut: comment reprocher cela à un enquêteur (le sociologue, antropologue des blancs, c'est le projet de jeune homme de Latour) qui veut noter rapidement ce qu'on lui dit?
La description de la modalité "dieu" correspond exactement à ce que je pense de la chose: bien loin de revenir à la preuve dit "ontologique" qui terrifie les faux athées, il s'agit de faire du divin quelque chose de parfaitement réel, et de parfaitement fictif donc réel. Mon objet G est pourtant bien supérieur en puissance, puisqu'il englobe et noie dans sa bave la frénésie idolâtre du constructiviste, attaché à la fois à sa carrière et au dézingage de l'autorité du blanc, c'est ce que lui disaient les blacks des années 70 qu'il interviewait, enfant.
Je pense qu'il est parfaitement possible de comprendre mais pas d'intégrer des conceptualisations du monde particulières et d'accorder droit de cité à des entités dans des contextes en faisant abstraction des soit disant "présupposés" qui, il faut bien comprendre que c'est la thèse fondamentale de tous ces idéalistes, gouverneraient nos pensées. Les fameux "schemes conceptuels" éreintés par Davidson sont bien là et je leur dis merde au passage, la liberté n'est question que d'occasion, il suffit de chercher, si on le peut. C'est donc au nom de la liberté que je me passionne pour ces bijoux là, surtout n'emprisonnez pas Latour, il est utile !
Bien sur, ce qu'on appelle le constructivisme et que je conchie est formé de thèses métaphysiques issues de généralisations abusives faites à partir de ces explorations. Même si on les a encouragé, le statut méphitique du chef de bande seyant aux sexualités modernes, elles sont surtout assumées par les abrutis, la connerie étant aussi un mode d'existence; connerie assumée aussi, il faut le dire par les tenants fanatiques de l'autre bord, ceux qui par excessive rigidité, se refusent à tout escapade au nom du bien, ayant chosifié leurs principes et procédant en permanence aux très longues et très chiantes formulations dans les systèmes axiomatiques anciens.
A ce propos, deux éléments, l'un lié aux simagrées formelles de Russel que la déduction naturelle de Gentzen réduisit à néant comme gymnastique, la "rigueur" qu'imposait l'axiomatique 1905 étant incluse de manière transparente dans la grande barre en 1935. Faut il s'inquiéter de cet abandon d'une musculation mentale qui sans doute a fait dégénérer la race ? Non, et c'est un nazi qui vous le dit.
L'autre, c'est l'aspect "constructiviste" qu'imposait les maths "modernes" jusqu'à la généralisation en pédagogie des analyses non standard: le passage par des raccourcis conceptuels simplifie beaucoup les démonstrations qu'on se devait autrefois d'asséner aux chtis étudiants. Là encore la race s'affesse, et saveur suprême, c'est la construction qu'on rembarre.
Bien qu'il soit sur qu'au passage, c'est bien des pans de la première modernité qu'on abandonne, faut il sans plaindre vraiment ? Et bien c'est la question et il faudra y revenir. Un élément de plus en passant est bien sur Averroes, qui ne laissait qu'aux philosophes le soin de divaguer, les étudiants de première année, trop prompts à se répandre dans la presse après l'abandon prématuré de leurs études devant être punis. Notons la solution islamique finalement retenue: il faut aussi interdire les philosophes. Mille ans d'immobilisme bigot qui se termine avec des drapeaux noirs.
Les ontologies rapides me semblent par contre donc un progrès, et leur pratiques à accepter, faut suivre sa civilisation, tout en conspuant de la même manière les vieux et les jeunes cons. Par contre, il faut rester XVIIème siècle et lire Racine, refuser qu'on vous sonne par SMS telle la soubrette, et donc rester Gaulliste. Na.
Les réalités
Pour rassurer leurs ennemis, les constructivistes se déclarent "réalistes". En fait ils sont hyper réalistes: il y a plusieurs demeures dans le pays de la réalité, et les démons des cérémonies vaudoues sont bien "réels", dans l'expérience terrifiante de conversion à la samba de l'ethnologue gavé d'atahuasca. C'est leur tropisme, il ne faut pas l'oublier.
L'Etre
Latour décrit Suriau comme philosophe de l'être "en tant qu'autre", par opposition aux philosophes de l'être en tant qu'être (Latour déteste Heidegger et sa technique).
Héritage
"Nous avons vraiment affaire à un problème d’héritage. Comment avoir confiance dans une tradition académique capable d’enfouir aussi profondément des philosophies d’une telle force ?"
La remarque est perfide et il est vrai que goinfré de Heidegger et de Foucault, nous n'avons ni Suriau ni Simondon. Enfin si, en fait, il suffit de lire...
Au passage, on n'a pas lu non plus Whitehead, le théoricien de la bifurcation (au XVIIème siècle, l'horrible mécanicisme, les qualités premières et secondes de Locke, la distinction sujet objet) qui veut après avoir bien combattu en faveur du logicisme avec son copain Russel, nous la fait organique, process et écologique... Il est aussi l'auteur de la théorie du process (ah ces foutus consultants). Ah l'écologie et son réenchantemement du monde tristounet. On a là le deuxième "anti" du monde monderne: non pas l'anti technique bêtement Heideggerien, mais l'anti rationalisme complexe des tenants de l'enjoyment... Au passage, on a un thème voisin: la "science" ne jouit pas. Déjà qu'elle ne pensait pas...
Ah quelle est belle pourtant la science, et celle du XXème siècle, faite précisément sous les yeux de Whitehead et de Heidegger! Créative et au combien, source de joie et de hahahah permanente et surtout dans l'axe de la visée de la compréhension du monde, quel qu'en soit les aspects. Qu'un vieux con de british veuille nous faire trembler en comparant le sec photon et l'humide coucher de soleil me navre... On dirait un pouilleux de berger boche dans sa clairière...
(1) Etienne Souriau http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/98-SOURIAU-FR.pdf
(2) la definition du politique par Latour http://www.persee.fr/doc/polix_0295-2319_2002_num_15_58_1003